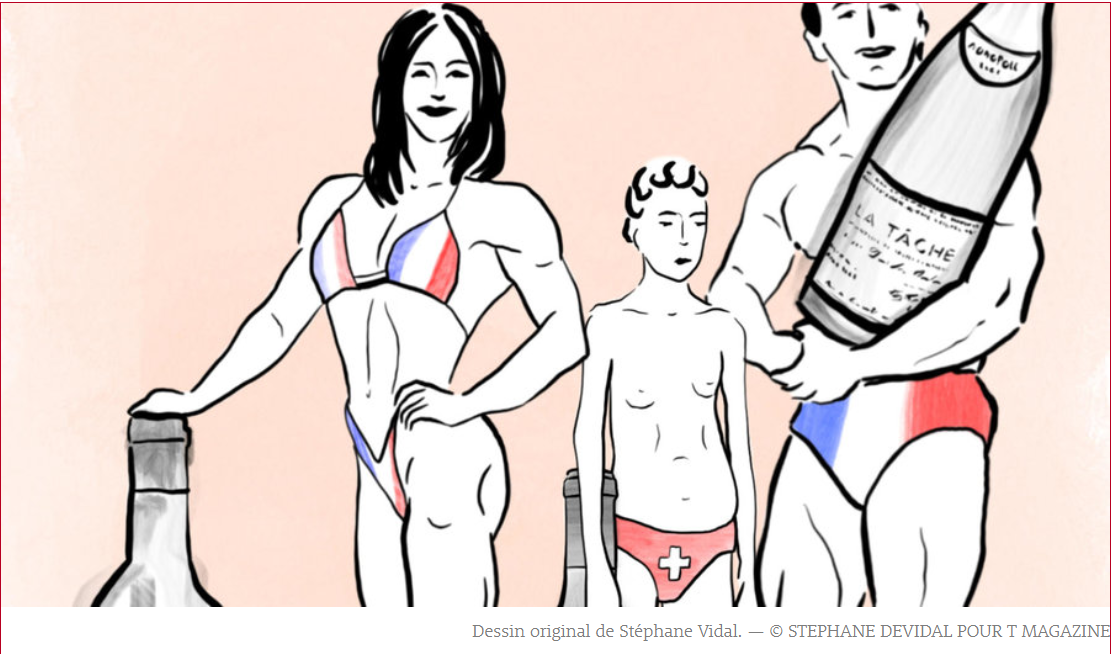Riche en alcool, pauvre en acidité, le cépage originaire de l’est de l’Espagne n’est pas facile à domestiquer. Mais il peut donner des cuvées d’une finesse et d’une profondeur remarquables, à l’image de la célèbre cuvée du domaine Henri Bonneau. Récit d’une dégustation extraordinaire.
Même si c’est le 7e cépage le plus cultivé au monde, le grenache noir reste largement méconnu en Suisse. Il y a deux raison à cela : il est totalement absent de nos vignobles, ce qui est relativement rare ; dans les régions où il est cultivé, il est très souvent assemblé, ce qui complique l’affirmation de son identité. C’est pourtant une variété à fort potentiel, comme en témoigne la réputation internationale de Château Rayas, la cuvée de grenache la plus célèbre au monde. Un mythe que j’ai eu l’occasion de déguster à plusieurs reprises, dont une verticale organisée en 2015 par le vigneron vaudois Raoul Cruchon.
Le 20 février dernier, c’est une autre dégustation exceptionnelle qui m’a permis de prendre la pleine mesure du potentiel des 100% grenache. Organisée au Kavo de Vevey par Laurent Maffli, un amateur passionné et éclairé, elle regroupait des grenaches pures (ou presque) issues de différentes régions du monde. Une sélection de haut vol, avec uniquement des cuvées de référence issues de différents millésimes. Elles ont été dégustées à l’aveugle par série de 2 à 3 vins.
En introduction, le généticien de la vigne José Vouillamoz et l’oeno-parfumeur Richard Pfister ont fait un focus sur l’origine du grenache et sur ses caractéristiques organoleptiques. Pour faire très bref, la grenache est originaire de la région d’Aragon, à l’est de l’Espagne. Sa présence en Sardaigne dès le 16e siècle, où il est appelé cannonau et où on revendique sa paternité, s’explique par le fait que l’île a été une colonie aragonaise de 1323 à 1720. Preuve supplémentaire que le berceau du cépage est aragonais: une biodiversité beaucoup plus développée, avec de nombreuses mutations (dont des grenaches grises et blanches, introuvables en Sardaigne).
Aujourd’hui, la grenache, avec ses grosses grappes bleutées, recouvre plus de 180’000 hectares sur la planète, dont 81’000 ha en France (Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Côtes-du-Rhône notamment) et 62’000 ha en Espagne (Aragon, Rioja, Navarre). On la trouve également en Italie, bien sûr, mais aussi Etats-Unis, en Australie et en Argentine. Les vins dont elle est issue sont souvent généreux, gourmands, avec peu d’acidité et une teneur en alcool élevée. Avec un grand défi pour les producteurs : garder de la fraîcheur pour proposer des vins digestes, élégants, avec une aromatique sur la cerise plutôt que sur le pruneau sec.
Continuer la lecture de « Le grenache noir sur le grill: la leçon de la Réserve des Célestins »