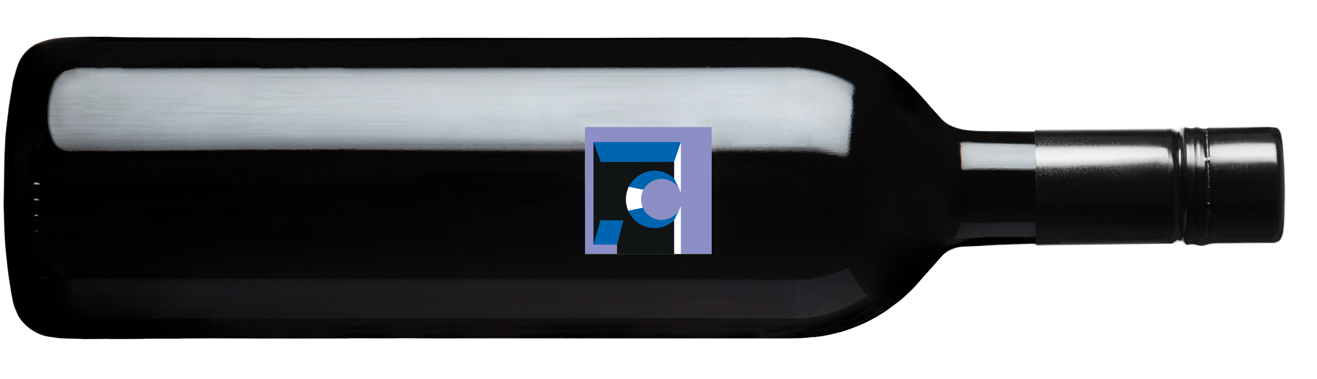Le chasselas de la famille Neyroud-Fonjallaz a gagné le titre de meilleur chasselas 2022 au Grand prix des vins suisses.
C’est un gage d’excellence. Déjà vainqueurs de la catégorie chasselas du Grand Prix des vins suisses en 2021 avec le Chardonne Chardon d’Argent 2020, Jean-François Neyroud-Fonjallaz et son fils Basile ont remis ça cette année avec leur Calamin 2021. Une victoire obtenue devant le Bouton d’or 2021 de l’Union vinicole de Cully et le Grand Cru Luins 2021 du domaine Le Petit Cottens à Begnins. Un tiercé qui confirme que le cépage originaire des bords du Léman reste avant tout une spécialité vaudoise.